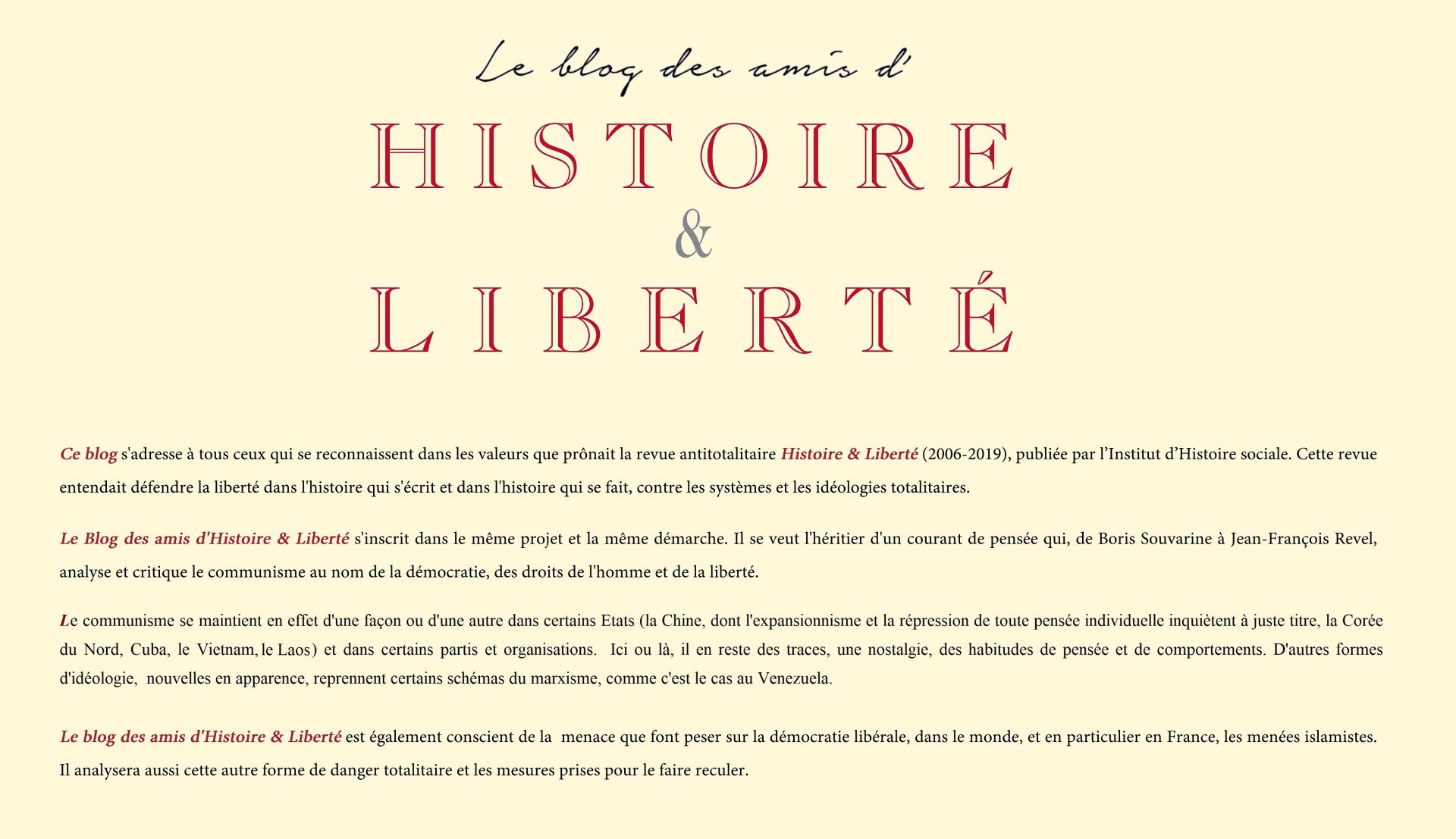Revue Esprit : Aux couleurs de la Chine, n° 470, 208p, 20 €

Il faut lire ce numéro de décembre 2020 de la revue Esprit pour son dossier sur la Chine, la majorité des articles qui le constituent permettant de réfléchir à la nature et au fonctionnement de l’Etat chinois. Le dossier en question s’ouvre sur une analyse de Jean-Philippe Béja, remarquable de clarté et de qualités pédagogiques. Il montre qu’avec Xi Jinping – et après une période où le totalitarisme commençait à se déliter, au temps de Zhao Ziyang puis de Hu Jintao – une reprise en main totalitaire a lieu sous la forme d’une mise au pas nouvelle de la société civile et d’une accentuation de la mainmise du Parti communiste sur l’Etat. Comme l’a dit Xi lui-même dans son rapport au XIXe Congrès du PCC : « Au nord, au sud, à l’est, à l’ouest, au centre, le Parti dirige tout ».
Ce qui nous oblige à reconnaître dans les Etats totalitaires l’importance du rôle des individualités au pouvoir.
Quant à Séverine Arsène, auteur d’Internet et politique en Chine (éd. Karthala, 2011), elle propose un éclairage tout en finesse sur le contrôle de l’informatique et par l’informatique. Son analyse nuancée montre un Big brother plus morcelé qu’on le croit et visant moins à faire taire toute voix dissidente qu’à marginaliser, voire à manipuler les opposants (la méthode castriste, en somme, plus que celle des Nord-Coréens).
Judith Geng et Mei Yang, sur le nationalisme chinois, Sébastien Veg, sur la question de Hong-Kong, soulignent la répression qui s’abat sur toute résistance – celle des Mongols, des Tibétains ou des Ouigours – à la sinisation. Le lecteur apprendra ici beaucoup sur les conceptions nationales des dirigeants chinois et sur l’importance de certains de leurs conseillers, tel Wang Huning, grand lecteur de Carl Schmitt.
Deux articles, l’un signé Justine Rochot, l’autre Capdeville-Zeng, s’intéressent enfin à la gestion de la pandémie de covid-19 par le pouvoir chinois et complètent ce dossier.
Ce dossier d’Esprit ? Un bon outil pour quiconque suit avec inquiétude l’évolution de la direction chinoise, moins tentée par un retour au désordre maoïste de la révolution culturelle que par une reprise du style de Staline ou de Liu-Shaoqi.
Benoît Villiers

Suite à cette évocation du n° d’Esprit sur la RPC, je signale, dans le n°1587 de Courrier international (1er au 7 avril 2021, p. 19),un article révélateur, assez savoureux, du Quotidien du Peuple (Renmin Bibao), intitulé « Cessez la comédie des droits de l’homme »
Selon l’organe du PCC, les droits de l’homme invoqués par les pays occidentaux, ne sont qu’une arme hégémonique, servant de prétexte à ingérences et à un interventionnisme militaire américain qui a « causé plus de 800.000 morts dont environ 335.000 civils depuis 2001 » ainsi que « des dizaines de millions de réfugiés ».
A noter que la propagande a beau jeu de profiter de nos auto-critiques, de notre ouverture et de notre liberté de la presse. Ce qui n’est certes pas une raison pour mettre à mal ce qui fait partie de la nature de la démocratie.
Le quotidien insiste sur l’affaire Floyd, le racisme aux USA, la discrimination des musulmans dans les pays occidentaux, les caricatures injurieuses, ces deux derniers points étant, rappelle-t-il, dénoncés par l’Organisation de la Coopération Islamique (laquelle semble décidément trop aimer l’argent chinois pour oser parler du sort des musulmans chinois).
L’organe central du PCC mentionne aussi la déclaration commune par laquelle « plusieurs pays dont la Chine, la Russie, la Syrie, l’Iran, Cuba, la Biélorussie, le Venezuela, la Bolivie, le Sri Lanka, les Philippines, le Laos, le Cambodge, le Zimbabwe et la Corée du Nord », dénoncent « les mesures coercitives prises de façon unilatérale par certains pays occidentaux, avec comme conséquences de graves violations des droits de l’homme. Ceux-ci devraient en tenir compte ».
Il estime, que, universellement, la comédie des droits de l’homme et l’hypocrisie des pays occidentaux qui jouent au « maître des droits de l’homme » ne prend plus. Et le quotidien de nous exhorter à « tomber le masque » et à régler nos propres problèmes en ce domaine.
Pierre Druez
Nous avons reçu cet autre commentaire suite au compte-rendu du dossier chinois d’Esprit.
Jean-Philippe Béja a choisi d’intituler son article dans la revue Esprit de décembre 2020 par l’expression « Xi Jinping ou le retour au totalitarisme ».
Celle-ci présente un immense mérite, celui de reconnaître publiquement que le régime actuel de Pékin est sans aucun conteste un régime totalitaire, ce que beaucoup de sinologues, d’éditorialistes et de partis politiques français n’osent toujours pas déclarer publiquement.
Mais la formulation s’assortit d’un inconvénient important : elle vient inopportunément troubler la compréhension du Parti Communiste Chinois à un moment où celui-ci n’a jamais autant mis en danger la démocratie libérale et la liberté dans le monde. La littérature chinoise elle-même ne nous enseigne-t-elle pourtant pas qu’il y a toujours avantage à bien caractériser l’adversaire ?
Pour qu’il y ait retour au totalitarisme avec Xi Jinping, il faudrait que le Parti Communiste Chinois l’ait préalablement abandonné. Or Jean-Philippe Béja s’abstient de nous proposer dans son article une période précise au cours de laquelle cela se serait produit.
Ce que je propose de montrer ici, c’est que, depuis sa prise du pouvoir en 1949, le Parti Communiste Chinois n’a en réalité jamais cessé de maintenir un régime totalitaire sur la population chinoise. Pour ce faire, j’utiliserai successivement deux approches distinctes.
Une première approche consiste à parcourir la période 1978-2012 pour savoir si on peut discerner une sous-période de sortie du totalitarisme.
Cette période 1978-2012 est celle qui sépare la Chine de Mao (au cours de laquelle chacun convient désormais que le régime politique était totalitaire) de la Chine de Xi Jinping (celui-ci accède au pouvoir suprême en 2012). Dans cette période, on a vu se succéder à la tête du Parti-Etat chinois Deng Xiaoping (1978-1989), Jiang Zemin (1989-2002) et Hu Jintao (2002-2012). Si on avait quitté le totalitarisme au cours d’une sous-période de la période 1978-2012, cela serait passé par une discontinuité marquante qui aurait nécessairement fait date et qui n’aurait pas échappé aux observateurs ; les dissidents chinois nous en auraient informés.
Pour prouver que cela ne fut pas le cas, rappelons ici quelques-uns des faits marquants du comportement du Parti au cours de ces 34 années (1978-2012) :
- En 1979, Deng introduit la politique de l’enfant unique (qui sera maintenue de 1979 à 2015) : une intrusion dans la vie personnelle et familiale qu’un simple régime dictatorial n’aurait pas pu mettre en œuvre et que seul un régime totalitaire pouvait imposer et faire respecter.
- A partir de 1979, le Parti met en place une politique qui vise et qui réussit à transformer une grande partie de la population des provinces intérieures en « ouvriers-esclaves » qui sont disponibles aux entreprises situées sur la grande zone côtière (le régime reconnaît officiellement 330 millions de mingongs, tous adultes ; ils forment environ un tiers de la population adulte chinoise). Un régime démocratique n’aurait jamais conçu une telle intention ; un régime « simplement dictatorial » aurait pu en concevoir le projet mais n’en aurait pas eu la capacité politique. A noter au passage que c’est cet esclavage du tiers de la population chinoise qui constitue la base essentielle des succès géopolitiques du Parti et qui facilite à celui-ci la « stabilisation politique » de la classe moyenne (la moitié environ de la population).
- En 1989, à Tien Anmen, s’amorce, ainsi qu’on s’en souvient, une répression sanglante et terrorisante contre le mouvement démocratique, en particulier contre les militants de la charte 08. Encore un autre symptôme de ce que le Parti n’avait alors pas interrompu son régime totalitaire.
- Les militants chinois pro-démocratie, au long de la période 1978-2012 et particulièrement depuis 1989, n’ont en réalité jamais cessé d’être ciblés, persécutés, incarcérés et même mis à mort (Liu Xiao Bo : incarcéré pour 11 ans en 2008, décédé en prison en 2017 d’un cancer sans que lui ait été appliqué le traitement pertinent).
- Signalons aussi les persécutions contre le bouddhisme et les Tibétains (surtout de 1987 à 1993 puis à nouveau entre 2008 et 2012), celles exercées contre le mouvement religieux Falun Gong (campagne de persécution lancée en 1999 par Jiang Zemin) et par ailleurs contre les chrétiens. Ces persécutions ont eu lieu bien avant l’accession de Xi Jinping au pouvoir suprême.
Au vu de cette chronologie, on discerne vraiment mal au cours de quelle sous-période et pour combien de temps on serait momentanément revenu du totalitarisme à « une simple dictature ». Au contraire, entre 1978 et 2012, par son comportement, le régime chinois a manifesté et a confirmé qu’il demeurait totalitaire sans aucune discontinuité.
Une deuxième approche consiste à analyser en quoi consistaient les mutations notoires qui sont intervenues dans les premières années de Deng induisaient une sortie du totalitarisme.
S’il existe une période où sont intervenues des mutations significatives en Chine, ce sont ces premières années de « la présidence Deng ». Ces mutations n’auraient-elles pas présidé à une sortie momentanée du totalitarisme ? On peut distinguer essentiellement deux modifications significatives intervenues à l’initiative du Parti :
- En premier lieu, le Parti, effrayé par l’impasse à laquelle conduisait le collectivisme tant en URSS que dans la Chine de Mao, a fait alors passer l’économie chinoise du collectivisme à « l’économie socialiste de marché », c’est-à-dire au capitalisme d’Etat.
- En second lieu, le Parti a modifié son idéologie, passant progressivement de l’idéologie marxiste-léniniste qui prévalait sous Mao (mais qui était devenue obsolète et inadaptée une fois qu’avait été décidé le passage du collectivisme au Capitalisme d’Etat), à une autre idéologie, une idéologie fondée à la fois sur un nationalisme agressif et revendiqué (la thématique du « rêve chinois » par laquelle le Parti prête à la population chinoise l’intention (qu’il a lui-même) de dominer le monde) et sur une mobilisation « anti-démocratique » conceptualisée et affichée (« la démocratie est un poison »).
Ces deux grandes modifications sont bien entendu majeures si on veut comprendre la transformation spectaculaire de la Chine depuis 1978 et si on veut comprendre les succès géopolitiques impressionnants et répétés qu’elle a obtenus depuis lors. Mais elles ont aussi la particularité d’avoir laissé absolument intact le système de domination politique du Parti. Elles n’amenaient en aucune façon le Parti à renoncer à l’emprise totalitaire qu’il exerçait sur la population chinoise depuis 1949.
Quand on est passé de Mao à Deng, le Parti Communiste Chinois n’a pas modifié son identité politique, il a seulement modifié la formule de son régime totalitaire. De la Chine de Mao à la Chine de Deng, on est ainsi seulement passé d’un type de totalitarisme à un autre :
- Deng et le PCC ont alors abandonné un totalitarisme de type marxiste-léniniste : « Collectivisme + Thématique de la dictature du prolétariat », un modèle inspiré par le modèle totalitaire de l’URSS
- Deng et le PCC lui ont substitué sans aucun délai un autre type de totalitarisme : « Capitalisme d’Etat + Thématique nationaliste agressive + Lutte revendiquée contre la démocratie », un modèle qui en définitive est beaucoup plus proche du modèle totalitaire de l’Allemagne et du Japon des années 30 que de celui de l’URSS.
Les deux approches distinctes convergent donc pour conclure que, depuis 1949, le PCC a maintenu son régime totalitaire sans aucune discontinuité.
Il reste alors une question subsidiaire : comment interpréter et caractériser les multiples « novations » que Xi Jinping a introduites depuis 2012 ?
Ces novations partagent une redoutable particularité commune qui consiste à faire évoluer le nouveau type de régime totalitaire dans le sens d’un durcissement multidimensionnel avéré :
- Un durcissement idéologique au sein du Parti : le Document N°9 en 2013 qui venait confirmer la lutte contre la démocratie libérale ; la volonté de procéder brutalement à une sinisation forcée de toutes les minorités ethniques, linguistiques ou religieuses pour aboutir à l’homogénéisation absolue que recherchent tous les régimes totalitaires ; l’insistance à rejeter les notions de liberté et de démocratie libérale comme simplement « occidentales » et non comme universelles ; la volonté de faire modifier dans le sens de Pékin le concept des droits de l’homme qui fut retenu par l’ONU après-guerre ; l’inscription de la Pensée Xi Jinping dans la Constitution chinoise ; la présidence à vie instaurée et votée par le PCC en faveur de Xi ; le contrôle accru des programmes et des enseignants dans les Universités….
- Un durcissement répressif à l’intérieur : le coup de force à Hong Kong (juin 2020) qui a mis brutalement fin à la formule « Un pays, deux systèmes » sans attendre l’échéance prévue de 2047 prévue par le Traité sino-britannique ; la sinisation forcée de la Mongolie et surtout du Sinkiang (après celle du Tibet) selon des méthodes génocidaires (si les victimes peuvent encore ressortir vivantes après leur incarcération dans des camps dits de « formation professionnelle », elles en ressortent marquées à vie et terrorisées à vie) ; la reconnaissance faciale généralisée assortie d’un gigantesque système de fichage ; le système de « crédit social » punissant les éléments « non conformes » et récompensant les zélés du régime….
- Un durcissement agressif à l’extérieur : la poursuite de l’invasion militaire de la Mer de Chine du sud ; les incidents frontaliers avec l’Inde ; une irresponsabilité coupable face au risque de contamination du covid de la Chine vers l’extérieur ; un refus absolu d’accepter une commission d’enquête indépendante sur le territoire chinois concernant l’origine du virus ; un refus de toute coopération internationale ; des sanctions économiques fortes contre l’Australie suite à sa demande publique d’une enquête internationale en Chine sur l’origine du virus ; les menaces insistantes et répétées sur Taïwan ; un renforcement continu des programmes d’armement….
Il est clair qu’avec Xi, le Parti Communiste Chinois est passé à une autre étape. Mais, faut-il le répéter, cette nouvelle étape ne consiste pas du tout en un soi-disant retour au totalitarisme. Cette nouvelle étape renvoie en réalité à ce que le Parti Communiste Chinois, c’est deux choses à la fois : un régime totalitaire ET AUSSI une stratégie impérialiste (une stratégie qui vise même à se subordonner tout le reste du monde).
Or, depuis la crise des pays occidentaux de 2008 (à l’origine de laquelle il ne fut d’ailleurs pas étranger), le Parti Communiste Chinois se sent fort et perçoit que, en conséquence même de sa stratégie, les pays démocratiques ne cessent de s’affaiblir relativement à lui. A tort ou à raison, il considère qu’une victoire finale lui devient prochainement accessible. C’est pour cette raison qu’il en arrive à rendre de plus en plus audacieuse et de plus en plus agressive sa stratégie impérialiste tout en rendant de plus en plus coercitif son régime totalitaire.
Mais ceci est un autre chapitre…
Dominique Duel
7 Avril 2021
Dominique Duel affirme que Jean-Philippe Béja parle à tort de « retour au totalitarisme » puisque la Chine ne l’a jamais quitté. Si elle l’avait fait d’ailleurs, un certain nombre de faits ou de positions politiques nouvelles en auraient témoigné.
Voilà qui manque de nuances. Le totalitarisme ne s’effondre pas d’un coup, sauf s’il est le produit d’une intervention militaire extérieure. Et Béja signale un certain nombre de faits et de positions politiques qui lui paraissent avoir été des indicateurs de ce début de délitement du système totalitaire :
-préconisation par Zhao Ziyang, alors secrétaire général du Parti de la séparation du Parti et de l’Etat et encouragement à la pluralité dans les Universités. Béja renvoie au rapport de Zhao Ziyang au XIII e congrès du parti..
Plus tard, Hu Jintao, secrétaire général du PCC de 2002 à 2012 et Wen Jiabao, Premier Ministre, ont souhaité l’intégration dans la Constitution de la défense des droits de l’homme et la propriété privée. A cette époque, la société civile commençait à se diversifier et des lignes politiques différentes apparaissaient dans le Parti.
Sans doute, peut-on difficilement parler de disparition du totalitarisme, mais de recul, de délitement, de mise en cause puis, après les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, de « retour » au totalitarisme dans sa plénitude avec la toute puissance d’un parti sans faille, l’absence de points de vue pluriels et de débats au sein de la représentation nationale et de la société civile.
Benoît Villiers