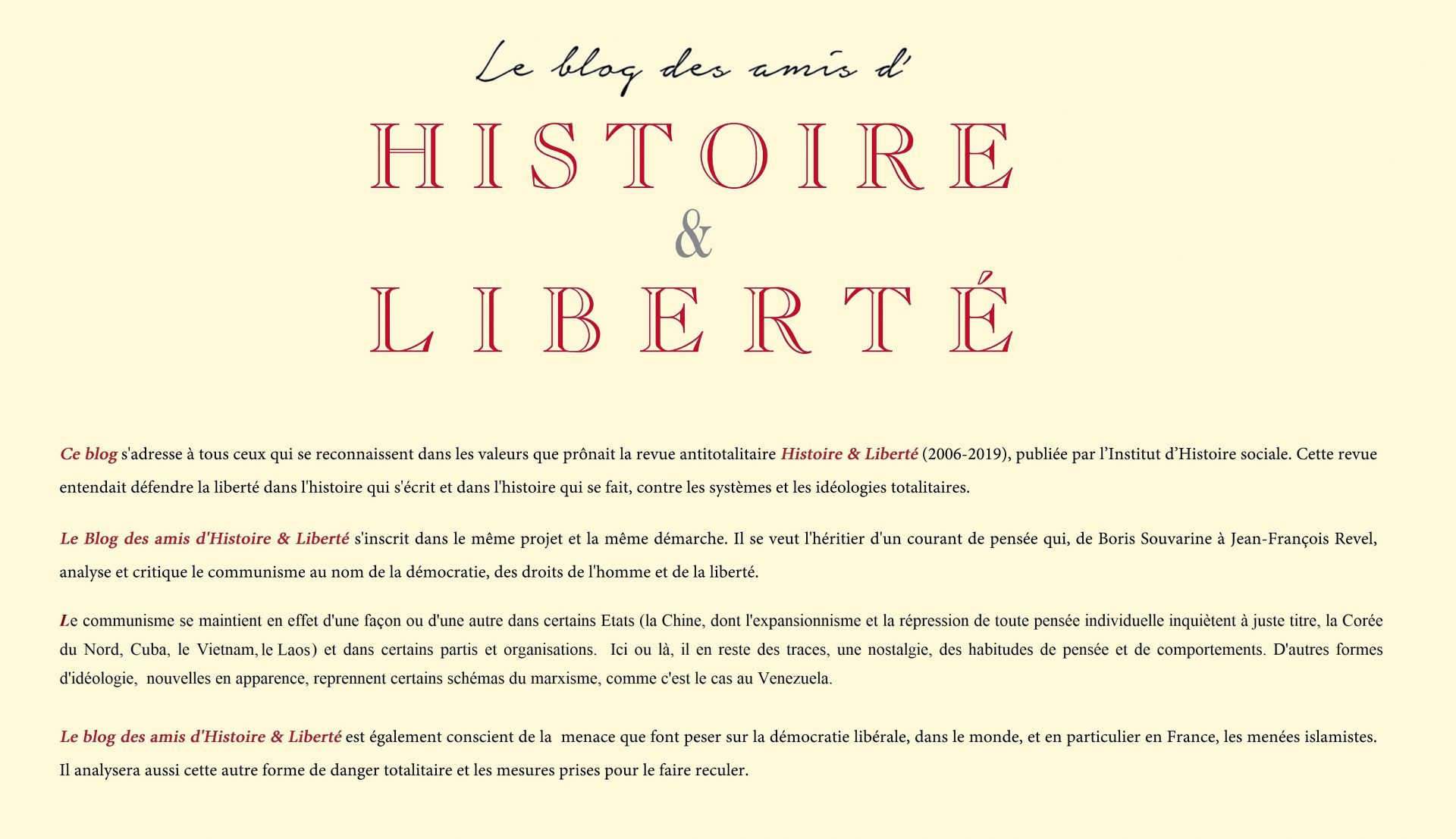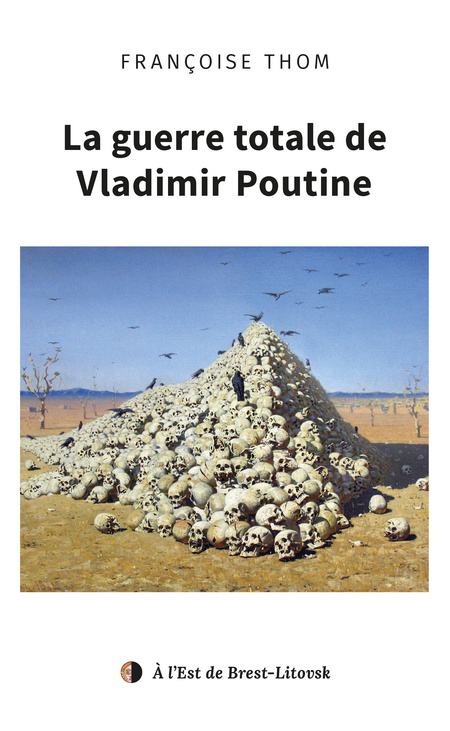Venezuela : quand l’anti-américanisme fait oublier 25 ans de désastre
Depuis plus d’un quart de siècle, le Venezuela vit l’une des plus graves catastrophes politiques, économiques et humaines de l’histoire contemporaine de l’Amérique latine. Pourtant, cette réalité est trop souvent reléguée au second plan, éclipsée par un anti-américanisme réflexe qui semble aujourd’hui plus mobilisateur que la dénonciation d’une dictature bien réelle.
Depuis l’arrivée d’Hugo Chávez au pouvoir, puis sous Nicolás Maduro, le pays a connu un processus méthodique de destruction de la démocratie. L’indépendance de la justice a disparu, la séparation des pouvoirs a été vidée de sa substance, les libertés publiques ont été systématiquement restreintes et la liberté d’expression violemment réprimée. Au Venezuela, plus de 400 médias ont été fermés ou confisqués au cours des deux dernières décennies, dont au moins 285 radios. Des dizaines de journaux ont disparu et, ces dernières années, 25 journalistes ont été emprisonnés pour des raisons politiques.
Il faut rappeler qu’il y a à peine deux ans, lors de l’élection présidentielle, le candidat de l’opposition a recueilli environ 70 % des suffrages, battant clairement Nicolás Maduro. Malgré cela, le régime s’est autoproclamé vainqueur avec près de 30 % des voix, au terme d’un scrutin largement dénoncé comme frauduleux. Face à cette confiscation flagrante de la souveraineté populaire, les réactions politiques et médiatiques en France ont été pour le moins timides.
Sur le plan économique, le bilan est tout aussi accablant. Plus de 60 % des petites et moyennes entreprises ont disparu, ce qui indique une contraction massive du secteur productif, dans lequel les PME jouent un rôle très important. L’inflation a atteint des niveaux record (en 2025, l’inflation annuelle a avoisiné 556 %).
Selon le taux de change officiel le plus récent, le salaire minimum au Venezuela, fixé à 130 bolivars par mois, soit actuellement entre 0,4 et 1 dollar américain. À ce niveau, il figure parmi les salaires minimums les plus bas au monde lorsqu’ils sont exprimés en dollars.
La situation est tout aussi critique dans le secteur universitaire public. Un professeur titulaire à temps plein perçoit un salaire mensuel d’environ 1,58 dollar américain, selon les données syndicales. Ces rémunérations, inchangées depuis plusieurs années, illustrent la forte précarisation du corps enseignant et expliquent en partie l’exode massif des professeurs.
Parallèlement, les prix des produits de première nécessité restent élevés par rapport aux revenus. À Caracas, le prix d’un carton de 12 œufs de gros calibre s’élève à environ 3,58 dollars américains, selon des bases de données de prix de détail, soit plus du double du salaire mensuel d’un professeur universitaire titulaire.
Ce contraste entre salaires symboliques et coût réel de la vie met en évidence la profonde déconnexion entre les revenus officiels et les conditions économiques auxquelles est confrontée la population vénézuélienne.
L’industrie pétrolière, jadis pilier du pays, a été ruinée par la corruption et l’incompétence. Il y a environ 20 ans, le Venezuela produisait plus de 3,2 millions de barils de pétrole par jour au sein de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), l’entreprise publique qui alimentait l’essentiel des recettes d’exportation du pays. Aujourd’hui, après des décennies de mauvaise gestion, de corruption et de désinvestissement, la production tourne autour de 0,9 à 1,1 million de barils par jour — soit moins du tiers de ce qu’elle était à son apogée.
L’agriculture vénézuélienne s’effondre : la production totale est passée de 20 millions à moins de 10 millions de tonnes entre 2008 et 2023, forçant le pays à dépendre massivement des importations pour sa survie alimentaire.
À cela s’ajoute un désastre écologique majeur dans l’Amazonie vénézuélienne, où l’exploitation illégale des ressources, sous contrôle militaire et avec la complicité de groupes armés étrangers, détruit les écosystèmes et condamne les populations autochtones à une misère extrême.
Dans cette même région du sud du Venezuela, le parc industriel qui entourait les entreprises de base de Guayana est aujourd’hui pratiquement démantelé : de nombreuses installations sont abandonnées, avec des hangars vides et des machines détériorées qui sont récupérées et exportées comme ferraille. Ce parc industriel, qui fut autrefois le cœur manufacturier qui visait à nous rendre moins dépendants du pétrole, témoigne désormais de l’effondrement du secteur industriel régional.
Les conséquences humaines sont dramatiques : plus de neuf millions de Vénézuéliens ont été contraints à l’exil, soit près d’un tiers de la population. Un exode massif, sans guerre déclarée, mais provoqué par la misère, la répression et l’absence totale d’avenir.
Comme le notait justement Ricardo Hausmann:
« Au cœur de cet effondrement se trouvait le démantèlement systématique des droits. Les droits de propriété ont été vidés de leur contenu ; les contrats ont cessé d’avoir un sens ; les tribunaux ont perdu leur indépendance ; les élections ont cessé de compter et s’exprimer est devenu un délit. À mesure que les droits disparaissaient, la sécurité, l’investissement, la confiance et la capacité d’imaginer disparaissaient eux aussi. Les gens ont cessé de planifier l’avenir, parce que l’avenir ne leur appartenait plus. »
Particulièrement grave a été l’action de la FAES, une force de police spéciale créée par Nicolás Maduro, responsable de l’exécution d’environ 1400 jeunes, majoritairement issus des quartiers populaires. Cette unité est impliquée dans des milliers d’exécutions extrajudiciaires. Ces pratiques ont été dénoncées par des organisations internationales comme constituant des crimes contre l’humanité. Face à ces assassinats, le tribun Mélenchon détourne le regard, fait semblant de ne rien voir. À cela s’ajoute l’enlèvement de citoyens étrangers utilisés comme monnaie d’échange diplomatique, parmi lesquels des ressortissants français, dont l’un a été récemment libéré après une détention totalement arbitraire.
Parallèlement, le Venezuela est devenu un espace d’influence pour des appareils sécuritaires étrangers, en particulier ceux de Cuba, de la Russie, de la Chine et de l’Iran. Ces acteurs ont contribué, de différentes manières, au renforcement du contrôle politique et militaire du régime. Ainsi l’expose avec clarté Laura Vidal, docteure en sciences de l’éducation :
« Le Venezuela n’était pas un espace exempt d’influences étrangères avant cette opération. L’implication cubaine dans les structures de renseignement et de répression est documentée depuis des années, facilitée par des échanges politiques et économiques incluant un accès privilégié au pétrole. La présence militaire russe est également bien établie, notamment à travers des opérations documentées liées au groupe Wagner. Le Venezuela demeure profondément endetté envers des créanciers chinois, avec environ 20 milliards de dollars de prêts ayant façonné une dépendance économique et restreint l’autonomie des politiques publiques. Enfin, l’Iran a fourni un soutien technologique qui s’est traduit par des outils de répression, notamment l’usage signalé de drones lors des manifestations de 2024.»
Face à ce constat, il est problématique que certains responsables politiques et acteurs médiatiques français analysent la situation vénézuélienne à travers un prisme quasi exclusivement centré sur la critique des États-Unis. Si cette démarche peut relever d’une tradition légitime d’analyse critique des relations internationales, l’anti-américanisme érigé en grille de lecture dominante, lorsqu’il conduit à relativiser ou à occulter un processus totalitaire avéré, constitue une impasse analytique et normative. Comme le rappelle Hannah Arendt, « le totalitarisme substitue à l’État de droit un système où la loi devient l’instrument de la domination » (Les Origines du totalitarisme). La réduction de la crise vénézuélienne à une causalité exogène empêche ainsi de saisir les dynamiques internes de monopolisation du pouvoir et de contrôle social propres aux régimes totalitaires contemporains.
Il est tout aussi faux que dangereux de qualifier l’opposition vénézuélienne « d’extrême droite ». Celle-ci est plurielle et rassemble l’ensemble des forces démocratiques du pays, y compris de nombreux partis de gauche. Ironie tragique : l’un des partis les plus persécutés par le régime est le Parti communiste du Venezuela.
La situation vénézuélienne ne saurait être interprétée comme le résultat d’un complot extérieur, mais doit être analysée comme la conséquence d’un mode d’exercice du pouvoir qui, au nom d’un discours se revendiquant révolutionnaire, a conduit à la désarticulation progressive d’un régime démocratique certes imparfait, comme toute démocratie, mais fondé sur des institutions pluralistes et fonctionnelles. Cette dynamique a abouti à l’instauration d’un régime autoritaire présentant des caractéristiques proches du totalitarisme. Il importe de rappeler que l’irruption de Hugo Chávez sur la scène politique s’est effectuée à travers une tentative de coup d’État en 1992, visant explicitement à renverser l’ordre constitutionnel et exposant gravement au danger la vie d’un président démocratiquement élu. Occulter ces éléments au nom d’un anti-américanisme réflexe revient non seulement à méconnaître la réalité empirique, mais également à ajouter une dimension de déni à la tragédie vénézuélienne, tout en traduisant une forme de complaisance intellectuelle à l’égard de l’un des effondrements politiques les plus marquants du début du XXIᵉ siècle en Amérique latine.
Chipilo Pulido, le 28 janvier 2026