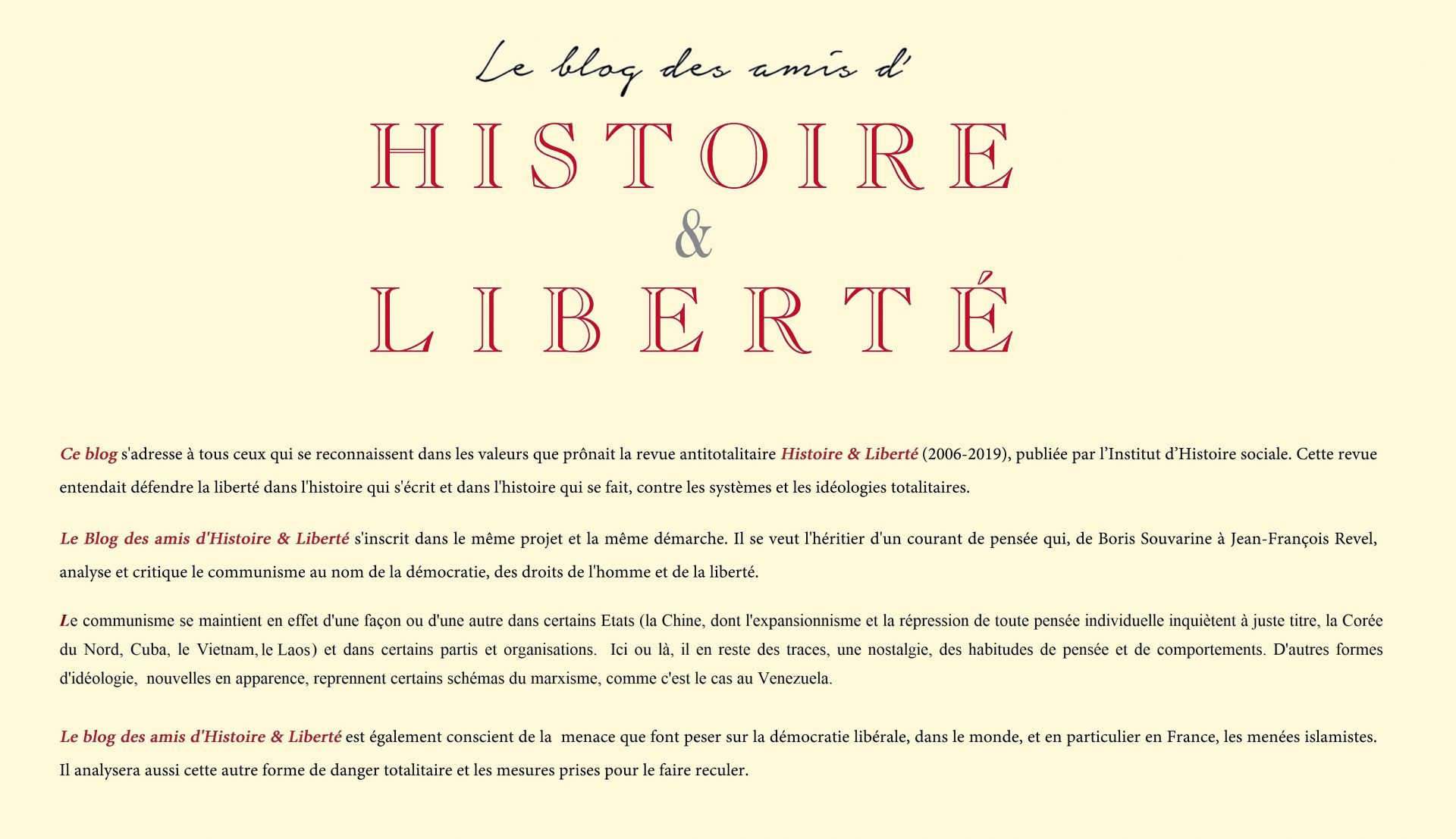LA MÉMOIRE DES ENTREPÔTS DE LA DÉPORTATION DE LA SNCF (II)
Au cours de notre périple, nous n’allions rien voir : seulement imaginer. Les « collabos » et les nazis passaient un simple coup de fil et les petits fonctionnaires responsables du tri fouillaient à l’intérieur des amas de minuscules appartenances ce qui les intéressait, pour les satisfaire immédiatement. C’étaient des serviteurs zélés des crimes ordonnés ailleurs, ou ici même. La vie continuait, comme avant.
C’était une ruche, avec son cortège de camions (il en arrivait un tous les quarts d’heure, avec les biens saisis dans les appartements des internée, puis déportés) et de wagons, formés en convois qui mesuraient environ 750 mètres, qu’il fallait remplir à ras bord avant de les envoyer en Allemagne (il y en a eu près de 1000 pendant toute la durée de l’Occupation).
Des halles, en fait, avec des entrepôts de toutes sortes, curieusement administrées par l’armée italienne sur une partie. Ou un gigantesque marché aux puces. Tout était conservé, à la différence des hommes, des femmes et des enfants qui, eux, pouvaient -devaient- être exterminés. La dispersion de leurs rares biens était sans doute destinée à faire disparaître ces témoins muets, éternels, des morts en déportation.
Ce silence devait devenir éternel. Malgré tous ceux qui assistaient à ce va-et-vient, les participants bien sûr, mais aussi les spectateurs, ceux qui voyaient tout depuis le métro aérien, passant pratiquement au-dessus. Et puis il y a eu la rénovation moderne, celle entreprise par le « collabo » puis « résistant » François Mitterrand, président de la République durant quatorze ans, qui entreprit, avec sa « Très grande bibliothèque », baptisée après « Bibliothèque François Mitterrand », d’enfouir tout cela sous des tonnes de béton et ses quatre gigantesques tours qui devaient, selon son architecte, Dominique Perrault, symboliser des livres ouverts (en équerre !). Un grand quotidien allemand titrait alors : « Mitterrand enterre la mémoire de la collaboration » Pourquoi un journal allemand ? Parce que, en France, jusqu’en ce mois de juillet 1995, au cours duquel Jacques Chirac, dans un discours rédigé par Christine Albanel, reconnaissait enfin la responsabilité indélébile de la France (j’étais présent : je n’en croyais pas mes oreilles), régnait le silence.
Mitterrand n’a pu mener son souhait d’oubli systématique jusqu’au bout. Il restait les « frigos », au sud de l’immense et impersonnelle bibliothèque. C’était une grande halle très allongée, qui servait à conserver les fleurs ou encore la viande entreposées là. Et les livres. Un grand bâtiment surmonté d’une tour blanche en a été le gardien. Peut-être même le précurseur de la bibliothèque mitterrandienne, une opération de prestige présidentiel destinée, en théorie, à soulager la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu, le siège historique, du trop-plein de livres et de documents. Pendant la construction de la très grande, personne n’avait pensé aux livres qui avaient été déposés autrefois juste en face. Et pourtant, il y en avait une quantité considérable : ceux qui avaient été volés aux Juifs après la rafle du Vel d’Hiv’ et les autres, moins connues, qui avaient eu lieu partout en France. Leur destination, c’était… l’Allemagne, où les nazis avaient pour projet de bâtir un musée contenant les témoignages sur les membres de ce peuple qui devait être éradiqué de la surface de la terre. Pour prouver au monde que c’était bien eux, les nazis, qui avaient réussi cette tâche, si souvent entamée et jamais menée jusqu’à son terme.
J’éprouvais une sensation de vertige en entendant Claude me raconter cela. C’est moi qui ai retrouvé la rue des Frigos, où il cherchait une plaque, invisible ce dimanche-là. Dans cette rue, l’on avait aménagé des ateliers d’artistes et des salles d’expo, sans doute dans le but de perpétuer une activité qui eût, inconsciemment, quelque chose à voir avec la culture.
Car qui savait ? Plus personne, hormis Claude, l’ancien cheminot, qui avait dû ruminer l’horreur tous les jours pendant tant d’années, remuant par ses questions indiscrètes, bousculant les dirigeants syndicaux, surtout les communistes qui préféraient glorifier une résistance tardive, parfois insuffisamment solidaire avec les déportés (et leurs biens !) acheminés dans les trains vers les camps. Les services de transport, ceux de la SERNAM, étaient désignés ironiquement sous le nom de « Buchenwald ».
Plus au sud encore, le site de la faculté de Tolbiac était surnommé le « shtetl », comme ces anciennes bourgades juives d’Europe de l’est, celles que décrivent les contes de Sholem Aleikhem et de tant d’autres écrivains, anciens ou plus contemporains, tels les frères Isaac Bashevis Singer et son Israel Joshua Singer, ou les tableaux oniriques de Marc Chagall avec sa belle Bella les survolant comme une bienveillante sorcière, s’en échappant avec lui. Là se retrouvaient, dans ce qui avait été un entrepôt et un centre de tri, des Juifs sortis temporairement du camp de Drancy, sous le prétexte ou l’illusion que leur vie allait être moins dure, mais ce n’était pas le cas.
Il nous fallait arrêter ce périple dominical sous canicule : trop chaud, trop émotif. Nous devions retourner dans des endroits où la mémoire serait moins prenante, tels le complexe de cinémas appelé « Bibliothèque » ou le gigantesque, ultra-moderne et branché incubateur de start-up inauguré par Emmanuel Macron, un jeune président pas du tout marqué par ce passé.
Nous devions quitter le périmètre de la gare d’Austerlitz, en nous réservant l’éventualité d’y retourner ultérieurement, nous promettant d’aller dans des gares de province où il ne restait que d’infimes traces de camps et de lieux de déportation, comme la gare de Nexon, près de Limoges, que Claude connaissait bien, où avait été interné en 1943 mon oncle David, avant d’être conduit lui aussi à Drancy.
Ici, c’étaient des hommes et des femmes et des vieillards et des enfants qui avaient séjourné avant leur mort à l’est. Pour cela, la SNCF avait dû présenter des excuses et procéder à certaines compensations, suite aux dénonciations d’abord du dirigeant des Verts Alain Lipietz, dont le père avait été déporté, puis des menaces de procès brandies par des avocats juifs américains, au nom des survivants ou des descendants de sacrifiés par les nazis, les « collabos », et leurs machines de transport, dans des conditions dignes non pas d’êtres humains, mais de bétail, et encore… Sous nos pieds, il n’y avait eu que des objets, la plupart disparus, certainement brûlés pour la plupart.
En quittant la zone, Claude et moi emportions sur nos vêtements et dans nos cœurs, dans notre âme, l’odeur de cet holocauste des objets, indélébile, malgré les années passées et les tentatives désespérées de leurs auteurs et leurs complices pour les effacer à jamais de la face de cette terre.
Jacobo Machover